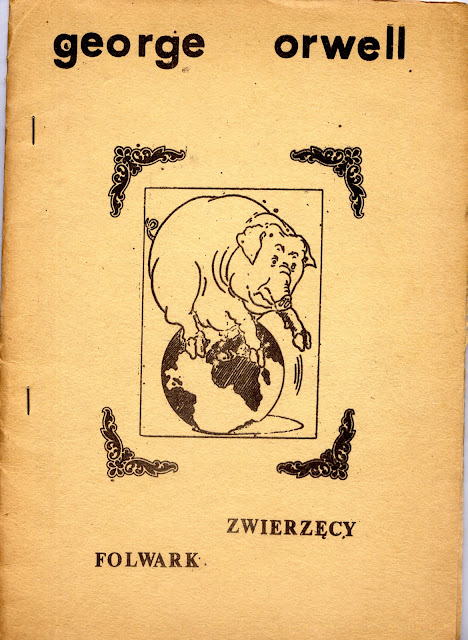Trip, de Tao Lin, c'est une sorte de réponse postmoderne aux Portes de la Perception, où l'auteur, comme Aldous Huxley, a entrepris de devenir « psychonaute », c’est-à-dire de documenter en temps réel ses expériences psychédéliques. Comme Huxley, il s’est drogué avec témoin et matériel d’enregistrement, dans le but de rédiger des rapports. Mais Lin pousse encore plus loin l’aspect scientifique : il va jusqu’à nous livrer des graphiques de sa consommation de drogues au fil des années, en relation avec son état mental. Cocasse ? Un peu, oui. Pourtant le propos est sérieux. Avant Trip, Lin déprimait. Il était attiré par des idéologies « lugubres, comme l’existentialisme ». L’un des enjeux de Trip était donc thérapeutique : plutôt que d’ingérer des antidépresseurs, Lin souhaitait explorer le monde des psychotropes illégaux, pour déterminer si certains l’aidaient à percevoir le monde différemment – et si oui, dans quelles contextes et à quelles doses. Vers la fin du livre, parlant de lui-même à la troisième personne, il explique en outre que « plus il en apprenait [sur les drogues], plus il se sentait aliéné des autres, et plus il lui était difficile de trouver des gens qui partageaient ses perspectives. C’était une autre de ses raisons pour écrire ce livre. Pour que les autres puissent savoir ce qu’il savait. Pour qu’il se sente moins seul à savoir. »
Le point de départ de Trip, c’est la fascination de Lin pour Terence McKenna. Figure de la contre-culture nord-américaine, ce théoricien anarchiste, spécialiste du chamanisme, était un fervent défenseur d’un usage responsable des drogues psychédéliques. Philosophe, ethnobotaniste, métaphysicien, « psychonaute » et historien de l’art, McKenna était le genre de savant-fou que les plus frileux qualifient volontiers de gourou. Lin croise d’abord sa route sur YouTube. Très vite, il développe une obsession pour les conférences vidéo où il expose ses théories. Exemple ? L’univers entier serait apparu d’un seul coup, sans raison ; au lieu d’un Big Bang initial, il existerait un « attracteur » – comme un mystérieux aimant – vers lequel tout se dirigerait. McKenna postule également que le monde est constitué de langage ; il considère l’imagination comme un continent inexploré, au sens propre, et comme le « lieu » de la vie après la mort, qui contiendrait notre univers et tous les autres. Dans un style différent, cette théorie rappelle celles de Pierre Bayard, critique littéraire français, dont les nombreux essais (aux Editions de Minuit) partent du principe que l’imaginaire est un territoire autonome, où toutes les œuvres de fiction, passés, présentes et futures, cohabitent et communiquent. On pense aussi à Abattoir 5, le chef d’œuvre de Kurt Vonnegut, où le temps ne s’écoule pas de façon linéaire, mais où tout ce qui est arrivé, arrive et arrivera jamais, a lieu simultanément… Ainsi qu’à des films de SF récents, comme Premier Contact ou Interstellar. Bien sûr ce genre de théories font appel à une grande ouverture d’esprit, et sont à envisager, non comme des vérités en attente d’être prouvées, mais comme des intuitions qu’il peut être ludique d’explorer. Pour ma part, en tant qu’athée elles sont agréables à considérer ; en tant qu’usager de psychotropes, elles me fascinent. Quand on a conscience de l’impact des hallucinogènes sur l’humanité – des mayas aux Beatles, en passant par Steve Jobs, Charles Manson ou le projet MK Ultra – et qu’on a eu l’occasion d’ouvrir certaines portes que révèlent ces substances, on est en droit de se questionner. Ce qu’on appelle aujourd’hui « psychédélisme » est-il en fait une forme de science avant-gardiste, encore à ses balbutiements, et dont certaines hypothèses finiront un jour par être considérées, si ce n’est confirmées, par la communauté scientifique ? Quel que soit le crédit qu’on accorde à ce genre de théories, Tao Lin fait preuve d’une remarquable ouverture d’esprit et d’un certain courage en les explorant.
Après une intro sur McKenna, où sont présentées ses théories et les grandes étapes de sa vie, le livre revient à Lin. On a droit à l’historique de sa consommation de drogues, caféine et nicotine comprises, ainsi qu’aux contextes dans lesquels il a commencé à les prendre. Puis vient la phase expérimentale à proprement parler, avec les comptes-rendus de « voyages psychédéliques ». Les plus extrêmes sont ceux où Lin fume de la DMT, drogue réputée provoquer des Expériences de Mort Imminente, ainsi que des rencontres avec des « anges », des « entités extraterrestres », ou ce que McKenna qualifiait « d’elfes mécaniques en mutation ». Là encore, les découvertes de Lin évoquent Abattoir 5 ou Interstellar… Mais autant s’arrêter là, pour ne pas gâcher le plaisir aux éventuels lecteurs. Je me contenterai d’ajouter que Trip, en plus de ses dimensions personnelles et biographiques, fourmille d’anecdotes et de théories sur l’histoire des drogues, mais aussi sur la philosophie aborigène, la littérature ou le capitalisme. Une sorte de guide de développement personnel dégénéré et moins foutraque qu’il n’y paraît, à la frontière de l’ésotérisme et du pragmatisme.